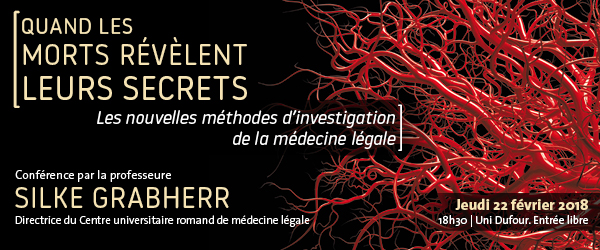La réussite scolaire : génétique ou culturelle ? Des données pour discuter l'interaction gène-environnement
La réussite scolaire est fortement corrélée au niveau d'éducation des parents. Le débat sur les causes de cette inégalité est fortement teinté idéologiquement. D'un coté on met en évidence le milieu socio-économique comme facteur explicatif principal et on évoquera des déterminants sociaux, de l'autre on évoquera les capacités propres de l'individu, sa responsabilité individuelle et on cherchera des déterminants génétiques. Le généticien Albert Jacquard disait que l'intelligence est 100% génétique et 100% culturelle - signifiant par là qu'on ne peut pas dissocier ces effets. Sans vouloir réduire la réussite scolaire à l'intelligence ni l'intelligence à la réussite scolaire (ce qui serait plus grave !), ni prétendre qu'il y aurait une mesure unique fiable et générale de l'intelligence en la mesurant par la réussite scolaire, cette boutade révèle les limites d'une pensée qui sépare culture et nature biologique. Des résultats récents le confirment et le quantifient.
Tremplin-Recherche… me croire ou aller vérifier à la source ?
Tremplins-recherche vous encourage à consulter l'original car il est facile de prédire que les médias se feront un plaisir d'interpréter cette recherche dans le sens de leurs propres idées et idéologies. Gageons que cela sera réduit à une conclusion sensationnaliste et définitive et que le contexte et les méthodes seront ignorés.
Pour une fois ce tremplin suit de près l'actualité !
Ne me croyez pas ... allez vérifier (Kong, A., et al., 2018) (Les membres Expériment@l-Tremplins peuvent obtenir ces articles…).
La réussite scolaire n'est pas simplement génétique OU culturelle !
Une étude publiée le 26 janvier dans Science (
Kong, A., et al., 2018), joliment intitulée "
The nature of nurture" quantifie les effets de ces interactions entre gènes (
nature) - et culture / éducation (
nurture).
Disposant de données génomiques et de réussite scolaires sur une très large part de la population Islandaise, ils ont effectué une étude
GWAS qui corrèle les variations d'un facteur (réussite scolaire
EA en anglais) avec les variations (SNP) le long du génome, pour 21'637 personnes (nées entre 1940 et 1983) dont ils ont le génome et celui d'au moins un parent. Ils ont d'abord trouvé qu'un ensemble de variations du génome influence (ou du moins corrèle avec) la réussite scolaire. Mais ce n'est pas là qu'est la surprise.
Des effets de l'allèle non transmis ?
Disposant d'un génome parental au moins pour ces 21,637 personnes, les chercheurs ont pu mettre en évidence une corrélation forte avec des variations sur les
allèles non-transmis depuis les parents !
On se souvient que la fécondation réunit une moitié du génome de chacun des parents, et donc pour chaque caractère génétique, un allèle de chacun des parents n'est PAS transmis.
Or ces allèles non-transmis corrèlent
aussi avec la réussite scolaire - certes moins que ceux transmis dans le génome, mais de manière forte et significative : "
an estimated effect on the educational attainment (EA) of the proband that is 29.9% (P = 1.6 × 10−14)". (
Kong, A., et al., 2018),
Le fait qu'un allèle non-transmis puisse avoir un effet peut surprendre. On explique en général aux élèves - avec le modèle "de Mendel" - que seuls les gènes transmis influencent le phénotype. On sous-entend souvent que cela seul détermine ce qu'est l'individu.
Or les chercheurs montrent bien que cet effet existe :
"A sequence variant that affects the phenotype of an individual is also likely to affect the parent from whom it was inherited (Fig. 1A). For some phenotypes, the state of a parent can influence the state of its child. This gives rise to a situation in which a child's phenotype is influenced not only by the transmitted paternal and maternal alleles (TP and TM) (Fig. 1A) but also by the alleles that were not transmitted (NTP and NTM). A good example is educational attainment (EA) (5, 6): The EA of parents provides an environmental effect for children, but one that has a genetic component (7, 8). We call this phenomenon "genetic nurture." (Kong, A., et al., 2018)

 Fig 1: Les gènes des parents même non transmis influencent leur éducation et leur culture et ont des effets sur les enfants - qui ont pu être mesurés [img]. Source : (Kong, A., et al., 2018)
Fig 1: Les gènes des parents même non transmis influencent leur éducation et leur culture et ont des effets sur les enfants - qui ont pu être mesurés [img]. Source : (Kong, A., et al., 2018)
Les effets génétiques sur le milieu, la culture, ... ?
Même lorsqu'on souligne l'influence sociale et éducative pour nuancer le génome, on sous-entend aussi que l'effet des gènes des parents se limite à ce qu'il y avait dans le zygote fraichement fécondé. Le reste est souvent considéré comme culturel, éducatif, social (
nurture dit Kong).
Ce que cette étude montre - et quantifie - c'est que le génome des parents - même les gènes ou autres séquences qui ne sont pas transmises - influencent la réussite scolaire. Donc il y a une influence génétique dans l'environnement culturel, éducatif, social. Et cet effet est considérable.
Genetic variants in parents may affect the fitness of their offspring, even if the child does not carry the allele. This indirect effect is referred to as "genetic nurture." Kong et al. used data from genome-wide association studies of educational attainment to construct polygenic scores for parents that only considered the nontransmitted alleles (see the Perspective by Koellinger and Harden, 2018). The findings suggest that genetic nurture is ultimately due to genetic variation in the population and is mediated by the environment that parents create for their children. Zahn, L. M. (2018. ici)
En d'autres termes il y a une
composante génétique de la transmission culturelle ! Donc l'effet des gènes sur la culture que transmettent les parents à leur enfant et qui influence la réussite scolaire.
C'est un peu paradoxal et remet en question cette séparation culture-nature : on ne peut plus penser de manière simpliste une séparation de ce qui serait "génétique" ou social. Désolé pour les idéologies... même celles avec lesquelles j'avais de l'affinité :-(
Comment le phénotype du parent influence-t-il le succès scolaire ?
Les auteurs ne développent guère - évidemment -
comment ces gènes auraient influencé le phénotype des parents.
"This indicates that the EA of the parent is an important part of the parental phenotypes (Y in Fig. 1A) through which genetic nurture operates, but it is far from all of it. The EA polygenic score is likely associated with intelligence, conscientiousness, and future planning. Parents with a high score enhance the nurturing of their offspring through many behaviors, not exclusively through their own EA." (Kong, A., et al., 2018)
Ils expliquent que ces gènes de
genetic nurture peuvent avoir influencé la manière dont le parent a construit un environnement éducatif: ils évoquent l'intelligence, l'application, la planification. Est-ce que ces variants interviennent dans la persévérance, l'implication des parents qui aurait influencé le succès scolaire de leurs enfants ? Le rapport au savoir des parents qui à pu donner du sens aux apprentissages des enfants ? Difficile d'extrapoler ! Pour l'intelligence, on sait combien la question est délicate - nous n'ouvrirons pas le débat ici...
En tous cas le déterminisme simpliste (génétique ou social) est encore plus difficile à défendre.
Gageons que cette étude stimulera d'autres études et des réanalyses de données existantes qui pourront apporter de nouvelles réponses à certaines des questions qui hantent le monde éducatif.
Est-ce que ce double effet des variants explique la difficulté à réduire ces injustices sociales dans l'éducation ?
Est-ce que ces variants chez les enseignants ont un effet ?
Quelles conséquences sur les pédagogies ?
Quelles conséquences sur les rapports parents-école ?
…
Et en français ?
Des études GWAS à remettre en question ?
Kong discute dans un Podcast (cf
ici vers le milieu) en quoi leur étude remet en question les études GWAS - qui ne corrèlent que le génome étudié (et non celui des parents) avec les effets recherchés ( ici éducatifs). Il estime que cela ne change pas les chiffres, mais leur interprétation : On doit maintenant distinguer les effets génétiques directs ( les allèles transmis) et les effets de ces mêmes gènes sur l'environnement, la
genetic nurture.
Les mêmes allèles peuvent ainsi influencer plusieurs fois (leur effet direct par le génome et leur effet indirect sur les parents qui impacte le milieu éducatif et familial : il estime que si l'effet indirect est d'environ 30% il s'y ajoute l'effet direct de ces gènes. Finalement l'effet cumulé de ces variations est de 1.3 au carré donc 69 % ! Voire plus si on prend en compte l'effet des frères et sœurs, oncles et tantes, etc.
"Our analyses implicitly assume that direct genetic effects and genetic nurturing effects are additive, but interactive effects could certainly exist and further complicate the interpretation of observed effects. Moreover, alleles other than those in the parents can also have an effect; for example, the genetic makeup of the population of the probands could also be an important environmental contributor to their phenotypes." (Kong, A., et al., 2018)
On ne peut plus conclure (dans les GWAS) qu'un variant ou un ensemble de variations génétiques influencent xxx (ici les effets éducatifs) sans envisager les effets culturels de ces mêmes gènes que ces études ne dissèque pas.
Mise en perpective par André Langaney Généticien
"Cette « hérédité du non transmis » s’explique bien et peut correspondre à une réalité à laquelle on n’avait pas pensé…
MAIS, il faut quand même rappeler quelques principes de base :
- les corrélations utilisées dans ce type d'études, comme les héritabilités, sont des propriétés des échantillons, et non des populations, des chromosomes, des gènes, des séquences ou des nucléotides si l’on travaille sur des SNPs. Les études de génomes entiers ne permettent donc de discuter de causalités qu’à titre d’hypothèses à vérifier et pas de les démontrer.
- en conséquence, les valeurs mesurées n’ont aucune raison d’être les mêmes sur des populations ou des échantillons différents, en particulier si les environnements ou les pools génétiques ne sont pas les mêmes. On mesure des propriétés statistiques de l’échantillon, et pas des caractéristiques biologiques de l’espèce, ni même de la population.
- avec les islandais, on est dans un cas très particulier de population endogame depuis longtemps et assez homogène sur le plan culturel. Si ce qui est mesuré témoigne d’un effet possible, son explication est particulièrement complexe, multi factorielle et les facteurs impliqués sont plus ou moins dépendants.
Toute généralisation autre que « il peut y avoir ou il y a sans doute des effets compliqués de ce genre » me semble donc abusive…mais les auteurs et commentateurs ne s’en privent pas !
Ce qui est sûr, c’est que leurs « résultats » quantitatifs sur les parts respectives du génétique transmis ou non transmis sont pour le moins prématurés, excessifs, sinon dépourvus de sens.
André Langaney professeur Honoraire, Université de Genève 23 Septembre 2019
(
Les membres Expériment@l-Tremplins peuvent obtenir ces articles…).
Laura Weiss pour une relecture et des commentaires précieux. Bruno Strasser pour des éclairages stimulants. Laurent Zahnd pour avoir indiqué le site de la RTS et permis de découvrir cette étude.







 Denis Jabaudon Professeur à la Faculté de médecine et directeur du Geneva Neurocenter de l'Université de Genève
Denis Jabaudon Professeur à la Faculté de médecine et directeur du Geneva Neurocenter de l'Université de Genève 
 Alexandre Dayer Professeur à la Faculté de médecine et directeur du NCCR Synapsy, UNIGE
Alexandre Dayer Professeur à la Faculté de médecine et directeur du NCCR Synapsy, UNIGE  Ariane Giacobino Médecin adjoint au Service de Médecine Génétique, HUG et Privat docente à la Faculté de médecine, UNIGE
Ariane Giacobino Médecin adjoint au Service de Médecine Génétique, HUG et Privat docente à la Faculté de médecine, UNIGE
 Edouard Gentaz
Edouard Gentaz  Petra Huppi
Petra Huppi 
 Pascal Zesiger
Pascal Zesiger  Hélène Delage Logopédiste et chercheuse à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE
Hélène Delage Logopédiste et chercheuse à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE
 Marc Ratcliff Maître d'enseignement et de recherche à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE
Marc Ratcliff Maître d'enseignement et de recherche à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE 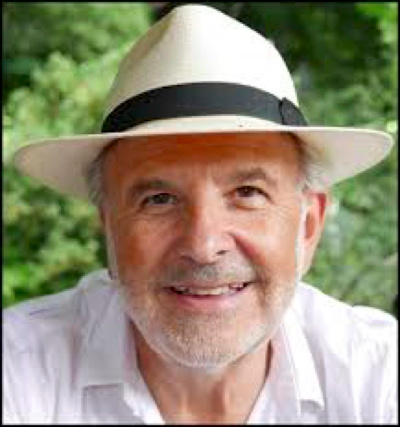 Pierre Barrouillet Professeur à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE
Pierre Barrouillet Professeur à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, UNIGE