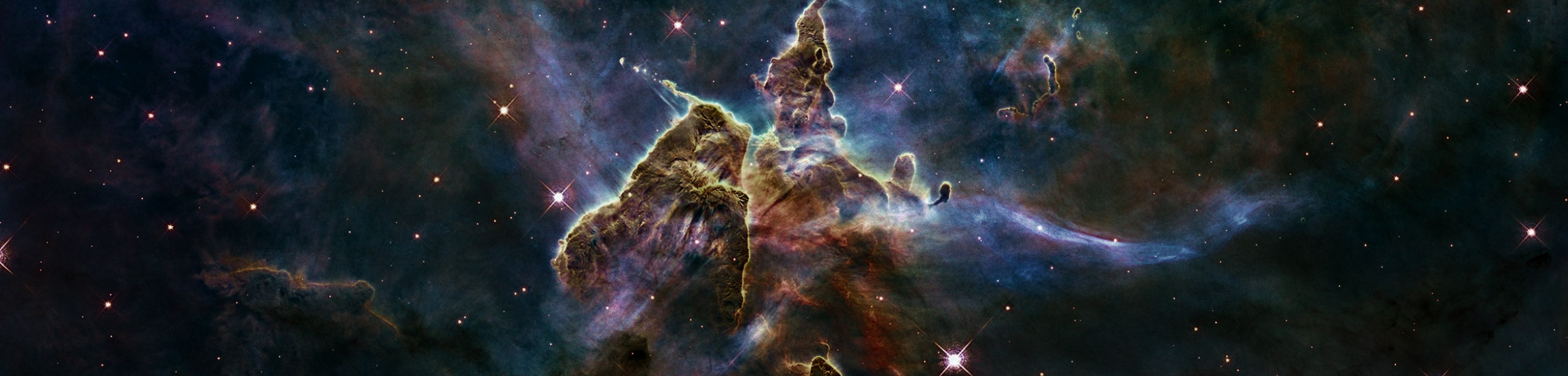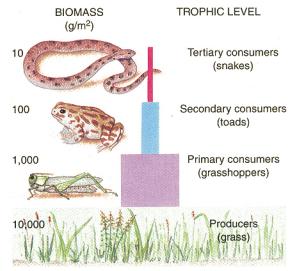Une offre magnifique pour les enseignants et aussi pour les élèves !
L'université de Genève offre aux enseignants genevois une large palette d'activités pour eux et pour leurs élèves :
En plus d'Expériment@l-Tremplins - spécialement pour les maitre-sse- s- les "Scopes" s'adressent particulièrement aux élèves (via les enseignant-e-s de science) : Bioscope, Chimiscope, Physiscope. (cf. plus bas par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux :-))
L'ensemble de ces activités et de nombreuses autres sont réunies dans un site et une brochure. Activités et ressources pédagogiques Cf plus bas.



Activités et ressources pédagogiques offertes par l'UNIGE
En plus d'Expériment@l-Tremplins - spécialement pour les maitre-sse- s- les "Scopes" s'adressent particulièrement aux élèves (via les enseignant-e-s de science) : Bioscope, Chimiscope, Physiscope. (cf. plus bas par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux :-))
L'ensemble de ces activités et de nombreuses autres sont réunies dans un site et une brochure. Activités et ressources pédagogiques Cf plus bas.
|


Activités et ressources pédagogiques offertes par l'UNIGE
L'adresse du site est : www.unige.ch/ressourcespedagogiques